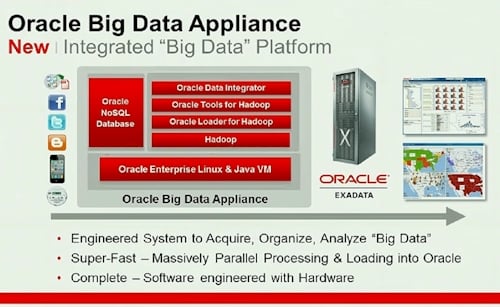Chez Antidot, nous avons une équipe R&D qui rassemble des développeurs de profils assez variés. Le terme de « développeur » ne doit pas être pris dans un sens réducteur, car ce sont des hommes et des femmes passionnés par leur métier, et qui non seulement codent bien des logiciels complexes mais qui, en plus, sont capables de prendre du recul sur leur métier et s’intéressent à l’évolution des technologies de l’informatique et de l’Internet, qu’elles impactent directement leur activité ou pas.
Aujourd’hui, nous avons choisi de partager sur le blog Antidot un billet écrit par Benoît Sautel, l’un de ces ingénieurs, qui partage depuis plus d’un an ses idées de « développeur passionné », comme il se définit lui-même, sur son blog « Fier de coder ».
Les concepts de Software as a Service ou de Cloud Computing sont de plus en plus répandus dans l’informatique d’aujourd’hui. Cela a pour conséquence que les éditeur de ogiciel ne vendent plus directement un logiciel mais le service que rend leur logiciel. Cette nouvelle façon de déployer du logiciel a changé la donne dans la façon dont sont conçus ces mêmes logiciels.
Vers un déploiement simplifié
Les architectures multi-tenant (multi-entités ou multi-locataires en français) ont vocation à faire en sorte qu’un logiciel soit capable de gérer un certain nombre de clients en une seule installation. Au lieu d’installer le logiciel une fois pour chaque client, ce dernier est capable de créer des environnement virtuels distincts pour chaque client de sorte à ce que de l’extérieur les autres environnements ne soient pas du tout visibles. En fin de compte, le logiciel répond lui-même aux problématiques de déploiement.
Dans le contexte d’un prestataire de service qui souhaite vendre son service à différents clients, l’architecture multi-tenant semble être la réponse évidente. Il suffit de déployer le logiciel une fois et de créer autant d’environnements que nécessaire, et le tour est joué. L’administration d’un tel système est, du coup, relativement simple.
Au prix d’une grande complexité dans le code
Je travaille en ce moment sur une application web basée sur une architecture multi-tenant. Et clairement ce type d’architecture a un coût dans le développement. Ce coût étant principalement dû à la complexité engendrée. C’est la raison pour laquelle je m’interroge à ce sujet.
Pour assurer l’isolation et l’indépendance des différentes instances, il me semble assez important de séparer les données de chaque instance dans une base de données dédiée. C’est une meilleure garantie de l’indépendance des données, mais c’est également pratique lorsqu’il s’agit de récupérer les données d’une instance pour transférer l’instance sur un autre serveur.
Tout cela implique qu’il n’est pas possible de considérer la base de données comme unique. On ne peut donc pas y accéder via un singleton dont on délègue d’ailleurs volontiers la gestion à notre outil de gestion de dépendances. Le connecteur à la base de données n’est plus un singleton, ce qui signifie que tous les composants qui s’en servent ne peuvent plus non plus être des singletons. D’ailleurs, la configuration du logiciel ne peut plus être non plus un singleton puisqu’il y en a une par instance. Bref, la perte de cette unicité limite très franchement le gain apporté par les outils et principalement ceux qui se chargent de l’injection de dépendance. Un peu comme si on retournait dans le passé.
Le code métier a bien souvent besoin de connaître sur quelle instance il travaille. Un objet représentant l’instance actuelle est ainsi passé en paramètre de la plupart des appels métier. La complexité de l’ensemble du code augmente ainsi fatalement et la testabilité prend du plomb dans l’aile. Difficile de faire du code simple dans une telle architecture.
De plus, une architecture multi-tenant ouvre une nouvelle gamme de risques de sécurité. Il n’est en effet pas envisageable qu’on puisse accéder à des données d’un autre environnement et encore moins de pouvoir les modifier. Pourtant, c’est le même code sur la même machine qui va gérer l’ensemble des environnements. Le risque est bien présent.
SaaS et architecture multi-tenant sont-ils vraiment compatibles ?
L’architecture multi-tenant a de nombreuses qualités quand il s’agit d’exploiter le logiciel en Software as a Service. Le logiciel sait nativement gérer lui-même l’ensemble des instances. Mais cela implique des contraintes auxquelles on ne pense pas forcément au départ.
Lors d’une mise à jour, si une régression est introduite, elle affectera immédiatement l’ensemble des clients. C’est un risque qu’il faut accepter de prendre, mais il peut être largement réduit en travaillant sur la qualité du logiciel. De la même façon, il est préférable de mettre à jour un logiciel à un moment où il est peu utilisé. Un logiciel multi-tenant implique de mettre tout le système à jour en même temps. Si les clients sont localisés un peu partout dans le monde, il est difficile de trouver un moment où tout le monde dort.
En général, un logiciel en SaaS est régulièrement mis à jour et évolue au fur et à mesure. Dans certains cas c’est tout à fait acceptable, si on considère par exemple que le service fourni par le logiciel se présente sous la forme de web services dont la rétrocompatibilité est assurée, les clients n’ont pas de raison de ne pas accepter les mises à jour. C’est davantage problématique quand le produit se présente sous la forme d’une interface graphique qui évolue régulièrement. Certains clients refusent catégoriquement que leur instance évolue et donc soit mise à jour.
Une architecture multi-tenant ne permet pas de mettre à jour certaines instances et pas d’autres. Il faut alors créer différentes installations du logiciel, chacun sur une version donnée. Et si on n’a pas de chance et qu’on n’arrive pas à trouver un petit nombre de versions pour satisfaire tout le monde, on se retrouve vite à déployer chaque client dans une installation distincte. Et là on a tout perdu. On a payé le surcoût lié à la complexité d’une telle architecture et on ne peut pas en profiter. Pire encore, on se retrouve à devoir quand même gérer une multitude d’installations, précisément ce qu’on souhaitait éviter au début.
Dev ou Ops ?
Se demander si les architectures multi-tenant sont pertinentes revient finalement à se demander où nous devons placer le curseur entre les parties Dev et Ops.
Dans les débuts de l’informatique, la moindre machine coûtait tellement cher qu’il était important d’optimiser chaque ligne de code assembleur des programmes de façon à économiser la moindre instruction processeur. Un gros investissement dans le développement des logiciels était nécessaire pour qu’ils soient capables de tourner sur des machines coûtant un prix raisonnable.
Mais, depuis ce temps-là, le monde de l’informatique a beaucoup changé. Les machines coûtent de moins en moins cher alors que leur puissance augmente, les réseaux se sont énormément développés, si bien qu’on n’achète même plus nous-même les machines mais qu’on paie un service d’hébergement (Infrastructure as a Service).
La virtualisation est venue ajouter une nouvelle dimension dans l’hébergement. Aujourd’hui, Docker est en passe de révolutionner une nouvelle fois ce domaine. On parle de plus en plus de Platform as a Service.
Tout cela est possible parce que le prix du matériel baisse sans cesse alors que sa puissance augmente. L’outillage s’est également adapté à ces changements et il est maintenant possible de gérer un parc de machines de manière quasiment automatique.
En parallèle de cette évolution en terme de technique, l’informatique est également de plus en plus populaire et même omniprésente. Mais le nombre de développeurs n’augmente pas aussi vite. Et jusqu’à nouvel ordre, il n’existe pas vraiment d’outils permettant d’automatiser le travail du développeur. Et heureusement pour nous !
Le curseur entre Dev et Ops s’éloigne petit à petit du développement. Il n’a jamais été aussi facile de déployer et d’exploiter du logiciel en masse (et ça sera certainement encore plus simple dans le futur).
Quel est le bon choix ?
Si la tendance actuelle se poursuit dans la même direction (ce qui me semble tout à fait probable), le déploiement sera de plus en plus automatisé et coûtera de moins en moins cher. Il me semble donc que dans le futur les architectures multi-tenant seront de moins en moins intéressantes.
Mais dès aujourd’hui, il me semble que le choix de partir sur une architecture multi-tenant n’est plus une évidence. Le logiciel en lui-même doit-il porter toutes les contraintes liées à son déploiement et la complexité qui va avec ? Grâce aux évolution des outils de déploiement, il est maintenant tout à fait possible de mettre en place en parallèle du logiciel une infrastructure de déploiement automatisée associée qui se charge de gérer ses différentes instanciations avec à chaque fois une configuration et une version bien précise. Ne vaut-il pas mieux développer deux systèmes distincts pour ne pas accumuler toute la complexité au même endroit ? Cela permet d’avoir à la fois un logiciel simple et toute la souplesse nécessaire au niveau du déploiement et de la gestion des différentes versions. N’est-ce finalement pas le moyen d’avoir le beurre et l’argent du beurre ?
L’image d’en-tête provient de Flickr.
Retrouvez les autres billets de Benoît sur son blog.
Et si vous avez envie de travailler chez Antidot, regardez les postes à pourvoir et écrivez-nous !